|
Huit
officiers et 429 chefs de brigade et gendarmes tel est l’effectif de la
Compagnie de gendarmerie de Moselle à la veille de la seconde guerre mondiale.
Composée
de 7 sections et 66 brigades la Compagnie elle est commandée par le chef d’Escadron
Valty et dépend, depuis 1919, de la Légion d’Alsace et de Lorraine dont le siège est à Strasbourg.
Installée à Metz, d’abord à la caserne Coislin,
puis à la caserne Féraudy [1]
rempart des Allemands, la Compagnie occupe
fin 1938 un bâtiment militaire 5
rue aux Ours.


Dans
la cour de la caserne 5 rue aux Ours
à Metz Col.part. DR )
Soumises depuis la crise des Sudètes à
une activité particulièrement soutenue, notamment dans les zones frontalières
et villes de garnison, les unités de la
Compagnie de Moselle vont à partir de
l’été 1939 enchaîner bon nombre de missions d’ordre administratif et militaire
dans des conditions souvent très
éprouvantes physiquement et moralement.
Dès le 10 juillet douze brigades
spéciales de gendarmerie frontière sont mises en place.
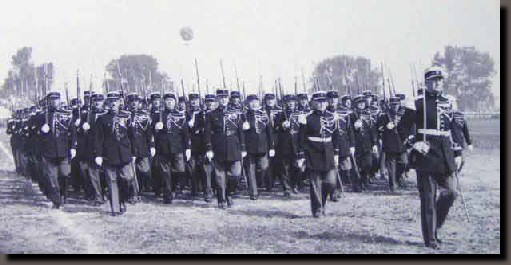
Metz:14 juillet 1939 dernier défilé de la Compagnie de Moselle
( Fonds Paul De Busson)
Le 21 Août toutes participent
aux opérations de mobilisation partielle par l'apposition d'affiches sur les
murs des édifices publics, le renvoi des permissionnaires vers leurs Corps et gèrent les
mouvements des premiers mobilisés de la
ligne Maginot ; services avec lesquels elles sont parfaitement
familiarisées depuis les alertes à
répétition de 1938
Dans
le même temps et alors que l’activité ne cesse d’augmenter la
gendarmerie départementale prélève
sur ses unités les effectifs nécessaires à la création des détachements
prévôtaux
formations d’une trentaine d’hommes, composées de motocyclistes et personnels en camionnettes,
chargées assurer la police du champ de bataille
ainsi que le contrôle des principaux nœuds de communication et dont les
premières seront sur pied dès le 27.
Le 24 Août 1939, sur ordre de l’autorité
militaire les familles logées dans les
Cités cadres de la ligne Maginot, les casernes de la Garde républicaine mobile
et unités de la Compagnie de Moselle
situées en « zone rouge » sont évacuées en vertu de la mesure
N°27 (Alerte renforcée) ; mesure dont l’application immédiate
contraint les familles à abandonner
leurs biens sur place pour
n’emporter que de maigres bagages à
main.
Ce départ précipité amorce un
gigantesque mouvement de population et d’effroyables drames humains auxquels
les unités de la Compagnie de Moselle vont
être confrontées jusqu’en juin 1940.
En effet, durant la journée du 1er
septembre, en même temps qu’elles apposent les affiches blanches annonçant la
mobilisation générale pour le samedi 2 à zéro heure, elles notifient aux maires
des localités des arrondissements de Boulay, Forbach, Sarreguemines et
Thionville l’ordre d’évacuation
immédiate de la population civile de la zone rouge vers l’intérieur de
la France.
Cette nouvelle mesure, à laquelle les
unités de la Compagnie de Moselle concourent activement aux côtés du 60ème
Bataillon Régional et du 68ème Régiment Régional, touche 210 000 personnes (femmes, enfants, malades et vieillards) de 214 communes
du département de la Moselle.
Tandis
que s’achève l’évacuation de la zone rouge et que la réquisition des véhicules
automobiles et des chevaux indispensables aux Armées bat son plein, la France et le Royaume-Uni, en réponse à l'invasion de la
Pologne par les troupes d'Adolf Hitler, déclarent la guerre au IIIe Reich.
Par crainte de la cinquième Colonne les autorités
ordonnent,,
le lendemain, le rassemblement dans des centres spéciaux de tous les Allemands
et Autrichiens de sexe masculins âgés de 17 à 50 ans. Des réfugiés Sarrois fuyant le régime
nazi, mais aussi de nombreux mosellans nés dans le département avant le
11 novembre 1918 et dont la réintégration
dans la nationalité française n’avait été pas réclamée sont internés à Rombas,
Maizières-lès-Metz, Briey, Pont-à-Mousson, ainsi qu’à Drancy.
Durant ce temps, les troupes débarquent en zone rouge où les
villages, les casernements évacués sont très rapidement mis à sac.
Mais ni les mesures
draconiennes ( ordre d’ouverture du feu sur les pillards, Conseil de guerre
etc.) mises en place par l’autorité militaires en charge de la protection des
biens, ni les missions (contrôles aux abords de la zone, surveillance des permissionnaires, envois de colis vers l’arrière, etc..)
confiées aux unités de gendarmerie ne
parviennent à enrayer le pillage.
Fin
septembre 1939, dès l’abandon du « Plan Sarre », deux commissions
militaires sont constituées en 6° Région et 20° Région militaire, sur
proposition du Préfet Bourrat , pour récupérer de la literie, des vêtements,
chaussures, machines à coudre, fourneaux et meubles dans les magasins et
maisons des évacués et les acheminer vers département d’accueil où ils font cruellement défaut.Une fois de plus et malgré leurs
nombreuses charges les unités de gendarmerie de la zone rouge participent à ces opérations jusqu’à l’offensive
allemande du 10 mai 1940 qui déclenche l’évacuation des 92 communes
jouxtant les ouvrages de la ligne Maginot ; là encore les brigades sont engagées
aux côtés des unités régionales.
Rue de la République à
Bouzonville –Militaires de la commission n° 2 conduite par le capitaine Pierre
Laundenbach – (Pierre Fresnay à l’écran )
récupérant du mobilier sous le contrôle d’un GD. (Fonds
Bourrat)
Le 12 juin le Chef d’Escadron Valty, commandant de la Compagnie de Moselle,
reçoit l’ordre d’évacuer immédiatement ses magasins et archives au Mans et de se tenir prêt à partir avec le 68°
Régiment Régional.
Le lendemain, il lui est prescrit de
regrouper à Lunéville les sections de
Forbach, Sarreguemines, Sarrebourg et Châteaux-Salins et à Metz celles de
Boulay, Thionville et Metz pour partir le 15 à Charolles, à la disposition de
la Direction des étapes de l’armée.Vers 13h30 le 14 juin 1940, pendant
qu’il fait ses adieux au préfet
Bourrat, le commandant de la Légion d’Alsace et de Lorraine parvient à lui
transmettre l’ordre de repli, avec Dijon comme point de regroupement.
Pendant que les troupes de forteresse
résistent sur la ligne Maginot, Metz, déclarée « Ville Ouverte », est
occupée le 17 par les forces nazies
et les jours suivants les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin, et du Haut-Rhin sont annexés de fait sans qu’aucune clause
de la convention d’armistice n’y fasse allusion. Le
territoire national est partiellement occupé militairement (zone occupée, zone
rattachée, zone côtière interdite, zone réservée, zone d’occupation italienne)
et une zone dite libre subsiste au sud de la ligne de démarcation.
La
Compagnie de gendarmerie de Moselle cesse définitivement d'exister.
En novembre 1944, après 4 ans d’absence, la gendarmerie
départementale s’installe à nouveau, rue aux Ours à
Metz où le 14 janvier 1945 est créée
la 21ème Légion de Gendarmerie.

Les
premiers éléments de GD lors de leur
entrée à Moyeuvre aux côtés des troupes
US.
En 1948 la qualité d’unités combattantes est attribuée aux trente
brigades de la Compagnie de Moselle.qui durant la période du 2 septembre au 9 mai 1940 ont séjourné dans la zone
de combat du nord-est.
Sur son
emplacement , face à la porte des Allemands , a été érigée la caserne des
Pompiers de Metz
Prévôtés d’Armée, de Corps d’Armée et de
Division
Décret du 1/9/1939
Sources
Fonds documentaires de l’Association
pour la Conservation de la Mémoire de la Moselle en 1939-45 – ASCOMEMO -
Hagondange
Retour
>>>> Accueil
Pour
tous renseignements merci de m'envoyer un courriel
à
cette adresse > mailto:roland.gautier4@free.fr
|
Copyright(c) 2009
Garde Républicaine Mobile de Moselle
. Roland Gautier - Tous droits réservés.
|
|